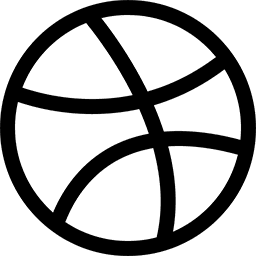Enfant, il s’appelait Emomali Rahmonov. Aujourd’hui, tout le monde le connaît sous le nom d’Emomali Rahmon, président du Tadjikistan. En 2007, lorsqu’il a officiellement supprimé le suffixe russe de son nom, il a déclenché un vaste mouvement de dérussification des noms et patronymes dans son pays. Une tendance qui s’est depuis étendue à toute l’Asie centrale et qui, avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, s’est encore renforcée.
Depuis la chute de l’Union soviétique, plusieurs réformes ont été lancées pour permettre aux citoyens de modifier leur nom de famille afin de, selon Nurlanbek Turgunbekovich Chakiïev, président du Parlement kirghiz, “préserver les traditions du peuple et affirmer l’identité nationale”. Lui-même a franchi le pas en devenant Nurlanbek Turgunbek uulu (“fils de Turgunbek”). L’homme politique a affirmé ainsi réaliser “un rêve de longue date”, comme il l’a écrit dans un post sur Facebook intitulé “Je suis le fils de Turgunbek, je suis le fils d’un Kirghiz !”, cité par Ozodlik, la branche ouzbèke de Radio Free Europe/Radio Liberty.
Début février, le Parlement kirghiz a notamment validé un projet de loi permettant aux habitants de choisir des noms de famille en accord avec les traditions nationales, tout en maintenant la possibilité de conserver les suffixes russes pour ceux qui le souhaitent, rapporte le site kirghiz 24.kg. Concrètement, cette réforme offre plusieurs options : au lieu des suffixes russes comme “-ov”, “-ev”, “-vich” ou “-ovna”, les parents peuvent désormais attribuer à leurs enfants les formules traditionnelles “uulu” (fils de) ou “kyzy” (fille de), ou d’autres déclinaisons propres aux spécificités linguistiques kirghizes.
Un héritage soviétique encore bien ancré
La russification des noms durant la période soviétique était une forme d’assimilation visant à uniformiser les populations et les langues sous une idéologie unique, rappelle Gaziza Uzak, journaliste et membre de l’Union des journalistes du Kazakhstan, citée par Ozodlik.
Comme l’explique le site d’information Newtimes.kz, l’URRS a misé sur la russification des noms de famille et des patronymes pour simplifier les démarches administratives, standardiser les documents et favoriser l’unité culturelle. De plus, l’éducation et la culture soviétiques valorisaient les prénoms et noms russes, largement représentés dans la littérature et le cinéma.
Dans certaines régions, avoir un nom russifié permettait d’éviter la discrimination. Newtimes.kz évoque ainsi des annonces comme : “Je ne louerai un appartement qu’à des Slaves”, qui poussaient les habitants à “se présenter comme ‘Nastya’, et non ‘Assiya’, pour résoudre un problème relevant du quotidien”.
L’invasion en Ukraine, un canalisateur du mouvement
Si pendant des décennies la russification des noms était un instrument d’assimilation, la guerre en Ukraine a profondément modifié la perception de cette influence russe dans l’espace postsoviétique. “L’invasion a stimulé les processus de décolonisation dans tout l’espace postsoviétique”, affirme Alisher Ilkhamov, du Central Asia Due Diligence, un centre de recherche établi à Londres, interrogé par Ozodlik. Il précise néanmoins que cette dynamique est plus marquée dans les sociétés où les identités tribales sont restées fortes.
“La civilisation urbaine qui existait sur le territoire de l’Ouzbékistan efface considérablement les différences ethniques.”
L’Ouzbékistan a néanmoins été l’un des premiers pays de la région à légiférer sur le sujet. Dès 1995, la loi sur la langue accorde aux habitants le droit d’écrire leur nom selon les traditions historiques du pays. Une procédure relativement simple : après un passage par le bureau de l’état civil, le traitement du dossier prend environ un mois. Mais, comme le souligne Ozodlik, cette transition est surtout appliquée aux nouveau-nés. Les parents remplacent les suffixes russes “-ov/-ova” et “-vich/-ovna” par les formules ouzbèkes “ugli” (fils de) et “kizi” (fille de).
“Une faible conscience nationale et patriotique”
Mais rompre avec l’héritage soviétique reste compliqué, et la dérussification ne s’impose pas partout. Au Kirghizistan, les statistiques révèlent même un mouvement inverse : en 2024, 198 hommes et 125 femmes ont supprimé les suffixes russes de leur nom, mais plus de 3 000 citoyens ont fait l’inverse, en les réintégrant, rapporte Ozodlik. Cette tendance s’explique par la forte présence de travailleurs d’Asie centrale en Russie. Selon Ozodlik, les autorités russes peinent à identifier les patronymes sans suffixes russes, ce qui complique l’embauche et les démarches administratives.
Même constat au Tadjikistan, un autre pays d’Asie centrale où l’émigration massive vers la Russie a conduit à un retour aux suffixes russes. En 2014, le procureur général tadjik s’était alarmé de voir de nombreux jeunes ajouter des suffixes russes à leur nom, qualifiant ce choix de “faible conscience nationale et patriotique”, d’après Ozodi, filiale tadjike de Radio Free Europe/Radio Liberty.
Devant cette tendance, le gouvernement a réagi : en 2020, le Parlement a interdit l’usage des suffixes russes dans les noms et patronymes, précise le site tadjik Asia Plus. Désormais, les nouveau-nés tadjiks doivent obligatoirement porter des suffixes locaux comme “-zod”, “-zoda”, “-on” ou “-purdokht”. Une exception a néanmoins été accordée aux minorités russophones du pays, qui peuvent conserver leurs suffixes russes.