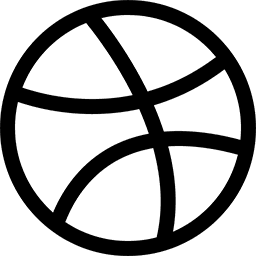Dans le parc de Bouba Ndjida, au Cameroun, les éléphants, très convoités pour leur ivoire, font les frais de l’avidité des braconniers. Au cours des deux dernières décennies, un programme de surveillance de l’abattage illégal d’éléphants a recensé plus de 3 004 éléphants tués en toute impunité dans cette région, indique Daily Maverick.
Toute une artillerie militaire est déployée chaque année dans le cadre de l’opération “Paix à Bouba Ndjida” : six cents soldats, soixante véhicules de combat et une unité d’élite de l’armée camerounaise, recense un article de l’Institut d’études de sécurité (ISS), cité par le média sud-africain. Ce dispositif onéreux (environ 2 millions de dollars par an) serait le seul choix sécuritaire possible. Ainsi en 2018, lorsque la présence militaire a été réduite, le braconnage a repris dans un contexte de défaillance sécuritaire, faisant huit morts à Bouba Ndjida.
Ce parc situé près du Soudan et du Tchad est régulièrement pris d’assaut par les braconniers. Les frontières poreuses rendent le parc vulnérable aux activités illégales. En 2012, 650 éléphants ont été tués par une faction de la milice soudanaise des janjawids. Face à ces forces militaires s’est opposée une résistance courageuse de villageois équipés d’armes traditionnelles.
Le Nigeria, aussi confronté à des problèmes de braconnage et d’exploitation minière illégale, utilise ces mêmes méthodes coercitives. En novembre, le ministre de l’Environnement, Balarabe Lawal, a exhorté les gardes forestiers à intensifier la répression contre les pilleurs de mines et les braconniers dans le parc national de Gashaka Gumti, à Serti, dans l’État de Taraba, indique le Nigerian Times.
Le ministre a aussi félicité African Nature Investors (ANI), une ONG nigériane, pour sa collaboration avec le National Park Service (NPS), une agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui lui a permis de mobiliser cinquante écogardes.
Abus flagrants
Selon l’organisation Survival, ce type de parcs protégés ségrègue les populations autochtones, les expulse avec violence et détruit leurs moyens de subsistance, relevait, en octobre 2024, la revue en ligne African Arguments.
En République démocratique du Congo (RDC), les dérives et les abus des écogardes sont des phénomènes fréquents, précise le magazine. En juillet 2024, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a rendu une décision historique en faveur des membres de la communauté batwa expulsés du parc national de Kahuzi-Biega, en RDC. L’organe de défense des droits de l’homme de l’Union africaine a ainsi reconnu les droits du groupe autochtone sur ces terres et a appelé le gouvernement congolais à les restituer à leurs propriétaires légitimes.
En 2022 déjà, l’ONG Minority Rights Group (MRG) révélait des abus flagrants commis lors d’une campagne militaire menée contre les Batwa, poursuit African Arguments. L’organisation a documenté une longue liste d’abus : tortures, meurtres, viols collectifs, bombardements de villages, décapitations.
Ces violations ne sont pas nouvelles, en 2018, des ONG internationales ont enquêté sur des abus commis par des écogardes dans le parc national congolais de Salonga, géré par une organisation internationale de renommée : le Fonds mondial pour la nature, ou WWF.
Problèmes structurels
Toujours selon la même source, des enquêtes officielles ont été menées aux États-Unis, ce qui a permis de mettre en place de nouvelles législations. Pourtant, les dépossessions et les violences commises à l’encontre des peuples autochtones perdurent. Pour cause : aucune des mesures annoncées ne s’attaque aux problèmes structurels de ces zones protégées, dont l’existence repose sur l’expulsion des populations locales.
Les ONG qui luttent pour la sauvegarde animale cherchent à réparer à court terme les dommages produits par le braconnage sans mettre en place des stratégies plus globales.
Contrairement aux aspirations des pays du Sud global, le plan d’action pour la biodiversité discuté lors de la COP16 a été financé par le Fonds de l’environnement mondial (FEM), avec une collaboration entre la Banque mondiale et diverses agences des Nations unies et les gouvernements. Une grande partie du financement est consacrée à l’objectif “30×30”, qui vise à accroître l’étendue des aires protégées de 30 % d’ici à 2030.