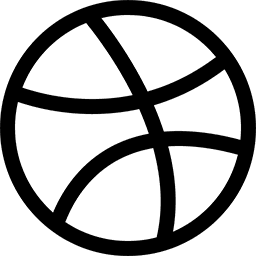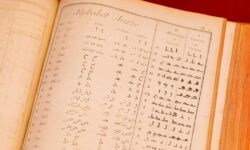Il est midi à Sicap Baobab, un quartier près de l’avenue Bourguiba, à Dakar. Dans son appartement où elle vient à peine d’emménager, Lissa Diop a du mal à se frayer un chemin dans ce désordre.
Le 7 février 2022, alors que le pays tout entier s’apprête à accueillir ses champions d’Afrique de football pour la première fois de son histoire, Lissa est avec un groupe d’amies parmi ces foules en effervescence. La jeune femme de teint clair, responsable de communication pour une société locale, était loin de s’imaginer qu’elle serait agressée.
“C’était sordide”
“Au début, je pensais que c’était juste un vol. Mais ils ont commencé à déchirer mes vêtements, certains à toucher mon corps. Au début, j’ai réussi à résister. Je vais beaucoup taper, beaucoup mordre. Je fais de la boxe. Par réflexe, je décide de me défendre, de rester debout au maximum. Je ne sais combien de temps cela dure, mais cela devient violent ; il y a des coups qui viennent de partout, je sens leurs mains sur mon corps, sur mes parties intimes. Au bout d’un moment, je commence à perdre des forces, mais j’essaie de m’accrocher”, dit-elle, encore affectée par cette mauvaise expérience.
Rentrée ce soir-là, elle avoue n’avoir pas pu dormir de la nuit et ne se souvient pas du visage de ses agresseurs.
“C’était assez sordide ; tu les vois, mais tu ne les reconnaîtras pas pour autant. Ils m’ont mise à l’écart dans un petit coin sombre. Ils étaient au moins dix et plus grands que moi. J’avais l’impression d’être une proie face à des animaux affamés. Sincèrement, je croyais que j’allais mourir. J’ai commencé à hurler, pas par peur, mais par colère, lâche-t-elle calmement. Ce n’était pas ma première agression, mais là c’était violent. À ce moment-là, je crois qu’une personne a entendu mes cris et cette personne s’appelle Omar, que je n’ai jamais retrouvé d’ailleurs après cette nuit. Il est parvenu à les chasser, à me tirer et à me ramener dans la foule.”
“Je me suis douchée pendant au moins trente minutes. Je me sentais tellement sale alors que je n’avais rien fait. Quand je suis sortie, je vois ma tête dans le miroir : j’ai un énorme œil au beurre noir et des blessures sur le visage et le corps. Quand ma mère m’a vue, elle était complètement paniquée. J’ai posté un message sur mon Instagram et de là tout le monde a été informé de mon histoire”, se souvient-elle encore.
Le cauchemar des transports en commun
Au-delà des rassemblements, les agressions sexuelles se poursuivent jusque dans les rues, mais aussi dans les transports publics.
Étudiante en troisième année à la faculté de médecine, Fanta Ndiaye, jeune femme de 21 ans, est encore tourmentée par un incident malencontreux qui lui a valu la phobie des transports publics.
“Il s’est frotté à moi. J’ai senti son sexe faire littéralement des va-et-vient sur mes fesses ; immédiatement, j’ai su. J’étais perplexe ; je ne savais pas quoi faire : devais-je crier ou le gifler ? Dans ma tête, je repensais à mes amies qui ont été insultées parce qu’elles ont osé dénoncer ces comportements inappropriés dans les transports publics”, fait savoir Fanta Ndiaye.
Voile blanc sur la tête, elle jette parfois un coup d’œil à sa pile de cahiers. Le regard hagard, Fanta réajuste sa longue jupe noire tombante. Confortablement vêtue d’un sweat-shirt, elle ne s’imaginait pas vivre ce genre de situation un jour.
“Je suis une fille voilée ; à chaque fois que je sors, je m’assure de porter des habits décents. Pour moi, il n’y avait pas de raison que ce genre de choses m’arrive.”
Même voilée, une proie facile
Au Sénégal, les transports publics – cars, bus et véhicules dits “clandos” – constituent le principal moyen de déplacement de la population. La majeure partie des besoins est satisfaite par des opérateurs privés, notamment les minibus Aftu, plus connus sous le nom de “tata”, les cars rapides et les taxis clandos, ainsi que Dakar Dem Dikk, l’opérateur public de transports en commun par bus.
Les services de Dem Dikk sont souvent décriés par les usagers en raison des longues attentes aux arrêts et de l’insuffisance des places assises à bord. Ce manque de places est la raison principale des agressions perpétrées dans les transports publics, affirme Bintou Ka, victime d’agressions sexuelles à plusieurs reprises dans les “tatas”. Elle se souvient d’une agression particulièrement marquante : “Ce jour-là, j’avais porté une burqa noire ; il s’est rapproché de moi ; j’ai senti son sexe ; je me suis retournée et lui ai lancé un regard noir croyant qu’il allait arrêter, mais il a continué”, dit-elle.
Pour ne pas créer de “scandale”, elle se déplace et va à l’avant du bus. “Évidemment, c’est gênant et énervant de savoir que, malgré notre habillement, nos précautions, notre voile, cela ne suffit pas”, affirme-t-elle, découragée par cette situation.
“Un vrai champ de bataille”
Mame Séga Lo est étudiante en master au département d’anglais de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. Elle a été victime de la même situation, accompagnée de ses deux sœurs, lors d’une course. Au retour, dans le bus, la jeune femme sent un homme la palper.
“Quand je lui ai demandé d’arrêter ce qu’il faisait, il a commencé à crier sur moi, disant que je l’accusais de me toucher et immédiatement des personnes dans le bus ont commencé à prendre sa défense. J’ai été choquée : c’est moi qui ai été agressée et c’est moi qu’on insulte !”
Heureusement pour elle, ses deux sœurs étaient là. “Le bus était devenu un vrai champ de bataille ; mes sœurs et une partie des passagers me défendaient, tandis qu’une autre partie était avec mon agresseur. Insultes, cris et larmes étaient au rendez-vous”, raconte-t-elle.
“Mon agresseur est descendu un peu plus tôt, à Poste Thiaroye. Nous sommes rentrés à Rufisque, mais une dame dans le bus a continué à nous insulter et à nous traiter de menteuses, faisant même des remarques sur nos habits, affirmant que si nous avions été agressées, c’était de notre faute.”
“Et aujourd’hui, en rentrant de l’université, j’ai encore été agressée par un homme dans le bus”, déplore Mame Séga… “La remarque est que ce genre de personne profite de la situation pour accuser les autres ou dire que c’est à cause du bus qui est plein qu’ils nous touchent”, dit-elle, indignée, elle ajoute que la solution c’est de ne pas se laisser faire sinon vous devenez une proie facile.

Le silence des victimes
Dieynaba Tall, 22 ans, a vécu une histoire similaire sur certains points. Rentrant chez elle après un week-end à Sicap Mbao, elle a été agressée dans un taxi.
“J’avais l’impression que c’était ma faute, que j’avais fait quelque chose pour mériter ça.”
De petite taille, l’étudiante en deuxième année à la faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg) à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar est drapée dans une robe wax qui camoufle à peine sa silhouette.
“Dès que je suis montée, il a commencé à me dire : ‘Peux-tu me rendre un service ? Tu sais, nous les hommes, on a des envies et on aimerait qu’elles soient satisfaites.’ Puis il a ouvert sa braguette et a dit : ‘Est-ce que tu peux me sucer ?’ Imaginez l’expression de mon visage ; j’étais stupéfaite et dominée par la peur”, lâche-t-elle dégoûtée.
Étonnée, la jeune femme croit vivre un cauchemar. “Il me suppliait de m’exécuter en agitant sans gêne son pénis devant moi”, dit-elle, frappée par un fou rire nerveux. Paniquée, elle ne savait plus quoi faire.
“J’étais choquée ; il faisait tard et en plus je ne connaissais pas le chemin par lequel nous passions”, a-t-elle assuré, dos au mur dans sa chambre d’étudiante à Claudel.
Alors que la voiture roulait à allure modérée, la jeune femme reste sans réaction et garde le silence, regardant devant elle. “Il continuait à dire qu’il avait besoin que je l’aide. Puis, sans hésiter, j’ai ouvert la portière et je me suis jetée dehors”, se rappelle-t-elle.
Par chance, il ne lui est rien arrivé ; une fois arrivée à la cité Alioune Sitoé Diatta (ex-Claudel), elle se contente de raconter cette histoire à ses amies, sans suite.
Les insuffisances et limites du cadre juridique
La question se pose dans les rues, les cars, mais aussi dans les écoles. Cependant, malgré sa notoriété, le harcèlement reste difficile à définir précisément ; chacune a sa propre conception. C’est “essayer de trouver du plaisir à l’insu d’une personne”, affirme Bintou Ka, journaliste. “Dès lors que tu n’as pas le consentement ou l’enthousiasme de la personne”, selon Lissa Diop ou encore “une violence exercée par une personne sur une autre dans le but de la blesser, mettre mal à l’aise ou minimiser”, estime pour sa part Dior Dieng, qualiticienne,
Le Code pénal sénégalais en son article 319 bis définit le harcèlement ainsi : “Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, gestes, menaces, paroles, écrits ou contraintes dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles par une personne abusant du pouvoir que lui confèrent ses fonctions sera puni d’un emprisonnement allant de six mois jusqu’à trois ans ainsi qu’une amende allant entre 50 000 jusqu’à 500 000 francs [76 à 762 euros] ! Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, le maximum sera prononcé.”
Cette définition du harcèlement sexuel reste limitée, explique Ndeye Coumba Kane, avocate : “Le Code pénal se concentre sur le harcèlement commis par une personne ayant autorité sur la victime dans un cadre professionnel, or nous constatons aussi des cas où il y a du harcèlement dans la rue ou ailleurs.” Les cas d’agressions dans les transports publics ou dans la rue peuvent être qualifiés d’attentat à la pudeur, nous dit Mme Kane.
L’attentat à la pudeur au Sénégal est un délit pénal qui concerne les agressions sexuelles sans violence physique, notamment envers les enfants et les jeunes. Selon le Code pénal sénégalais, cette infraction est punie de dix à vingt ans de réclusion, avec des peines aggravées pour les mineurs, allant de quinze à trente ans. Les peines varient en fonction des circonstances des faits et de l’âge de la victime.
“Les femmes sont dans une situation de domination quasi permanente”
À l’association des femmes juristes du Sénégal, le principal souci concernant le harcèlement sexuel au Sénégal est la banalisation du sort des victimes et le manque de dénonciation, nous dit Madjiguène Sarr, l’une des juristes : “Les violences faites aux femmes traduisent des rapports inégaux entre hommes et femmes, qui tiennent leur origine du système social basé sur le patriarcat. Ce système crée et perpétue des préjugés et stéréotypes sociaux néfastes envers les femmes, ce qui les maintient toujours dans une situation de domination quasi permanente.”
“Pire, ces violences ne sont pas suffisamment dénoncées par la victime, qui est gardée sous silence sous l’emprise de la culpabilité, de la peur, des préjugés. Et même dans les rares cas où elle est dénoncée, la femme victime n’a souvent aucun soutien, aucune aide, ou ne connaît pas les services disponibles. Les stéréotypes, pesanteurs et réalités socioculturelles de la société font qu’elle est souvent incriminée, stigmatisée. “
De 2021 au premier trimestre 2024, les boutiques de droit de l’Association des juristes sénégalaises (AJS) ont reçu plus de 1 132 dossiers de violences conjugales, avec une tranche d’âge variant de 18 à plus de 70 ans.
Les cas de harcèlements insuffisamment dénoncés représentent juste 1 % des cas reçus et traités au niveau de leurs neuf boutiques de droit, qui sont des centres d’écoute et d’assistance juridico-judiciaire mis en place par l’AJS depuis 2009.
Et pourtant, selon une étude de l’ANSD [Agence nationale de la statistique et de la démographie], 17 % des femmes âgées de 15 ans ou plus ont subi des violences sexuelles hors du cadre conjugal au moins une fois dans leur vie.
Les victimes sont toutefois rares à déposer plainte pour harcèlement ou à engager des poursuites ; la plupart de celles questionnées par nos soins expliquent que cela ne sert à rien.