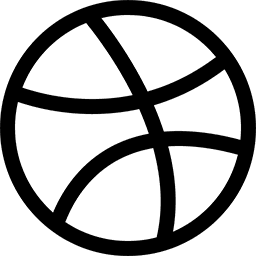Parmi les contentieux qui empoisonnent toujours les relations entre la France et l’Algérie, c’est l’un des plus difficiles à solder. Entre 1960 et 1966, la France a procédé à 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien : quatre explosions atmosphériques à Reggane, de février 1960 à avril 1961, et treize souterraines à In Ekker, entre novembre 1961 et février 1966. Des « crimes nucléaires », selon Ibrahim Boughali, le président de la chambre basse du Parlement algérien, qui s’exprimait jeudi 13 février à l’occasion d’une journée d’étude organisée à l’Assemblée populaire nationale (APN) pour le 65ᵉ anniversaire des premiers essais.
Après des mois de tensions entre Paris et Alger, ces commémorations, d’une ampleur inhabituelle, ont été particulièrement scrutées. Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, en route pour le sommet de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, n’y a pas pris part. Mais les présidents de l’Assemblée et du Conseil de la nation (la chambre haute) n’ont pas ménagé leurs critiques contre Paris, d’une part sur le nettoyage des sites et l’enfouissement des déchets, d’autre part sur l’indemnisation des victimes.
La France, selon Ibrahim Boughali a la responsabilité de nettoyer les zones contaminées par les radiations et les déchets nucléaires et de remettre à l’Algérie les archives complètes des sites d’essais, afin « que nos experts puissent évaluer les dégâts et prendre les mesures appropriées à leur égard ».
« Compensation symbolique »
Car le dossier, s’il n’est plus tabou, n’en finit pas de traîner. En décembre 2007, à la suite de la visite du président Nicolas Sarkozy à Alger, un comité algéro-français avait été mis en place pour établir « un état des lieux sur les sites pollués afin d’en diagnostiquer la radioactivité, d’en déterminer les risques sur les habitants et l’environnement, et de proposer des mesures de réhabilitation ». Sans parvenir à clore la question.
En 2014, un nouveau groupe de travail avait vu le jour en application de la « déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération entre la France et l’Algérie » signée le 19 décembre 2012 lors de la visite du président François Hollande. Puis, en 2021, dans son rapport sur la mémoire et l’histoire de la guerre d’Algérie, l’historien Benjamin Stora avait appelé à « la poursuite du travail conjoint concernant les lieux des essais nucléaires en Algérie et leurs conséquences ». Sans plus de résultats.

Écouter aussi Algérie-France : pourquoi les relations sont-elles au plus bas ?
Pourtant, comme le souligne un journaliste algérois souhaitant garder l’anonymat, les relations entre Alger et Paris auraient grandement besoin d’être « décontaminées », et « le dossier des essais nucléaires pourrait en être l’amorce, car leurs effets sur le terrain sont réels et ont besoin d’un traitement qui n’a que trop tardé ». « Cela permettrait en outre de donner une compensation symbolique à l’Algérie face au déséquilibre induit par la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental », souligne la politologue Louisa Dris-Aït Hamadouche.
Selon l’estimation faite par l’agence Algérie Presse Service (APS) en 2012, les essais nucléaires effectués en 1962 ont rendu malades au moins 30 000 Algériens. L’association Taourirt, représentée par Boubaker Ibbeh, œuvre à la collecte des témoignages et à la sensibilisation des habitants sur la persistance des radiations. Elle recense les effets des essais, notamment les maladies et les malformations congénitales qui affectent encore la population. Une autre association, dite du « 13 février 1960 » et basée à Reggane, effectue le même type de travail. Toutes deux réclament une reconnaissance internationale et une enquête sur ce qu’elles considèrent comme un « crime contre l’humanité ».
« Le climat est délétère »
A ce jour, un seul Algérien figure parmi les 545 victimes indemnisées (pour l’essentiel, des contaminés en Polynésie française) par le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) créé par la loi Morin de 2010. Un constat accablant, mais que le Civen justifie en expliquant que les dossiers reçus d’Algérie (52 seulement sur un total de 1 739) ne répondent pas aux critères de la loi Morin. Les demandes seraient trop mal ficelées et incomplètes pour que Paris puisse donner suite.
Restez informés
Suivez-nous sur WhatsApp
Recevez l’essentiel de l’actualité africaine sur WhatsApp avec la chaîne du « Monde Afrique »
Rejoindre
En réalité, deux logiques s’opposent : le dispositif français d’indemnisation au cas par cas et la demande algérienne de réparations plus globales. Il faudrait « indemniser l’Etat algérien et ce dernier prend ensuite en charge ces victimes », résumait en 2021 l’ingénieur nucléaire Amar Mansouri, très actif au sein de la société civile algérienne, interrogé par Le Monde.
Paris n’a pas réagi, vendredi, aux déclarations des responsables algériens sur les essais nucléaires. Depuis l’été 2024 et la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, les relations entre la France et l’Algérie traversent une crise majeure, Alger étant le principal soutien des indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Les tensions se sont encore aggravées avec l’arrestation et l’incarcération de l’écrivain Boualem Sansal pour des déclarations au média d’extrême droite français Frontières jugées attentatoires à l’intégrité territoriale algérien.
« Le climat est délétère. Nous perdons du temps avec le président Macron », a réagi Abdelmadjid Tebboune, début février, dans un entretien au journal L’Opinion, disant vouloir éviter une « séparation qui deviendrait irréparable ». Depuis, la crise a semblé s’apaiser, la presse algérienne mettant en avant les appels au dialogue et à la désescalade portés par des personnalités politiques françaises comme Dominique de Villepin ou Ségolène Royal.