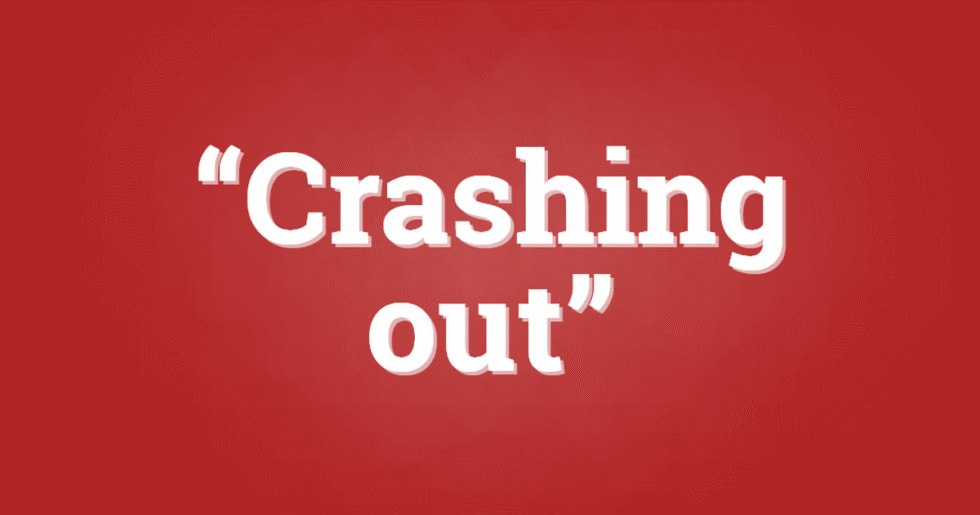

Recroiser son ex dans la rue, vivre un énième date infructueux, se sentir submergé par les notifications, voir son loyer augmenter, ou son gouvernement prendre un virage autoritaire… Autant d’émotions négatives et de frustrations accumulées qui peuvent nous faire nous sentir submergés, et nous faire piquer une colère.
Mais comment les résumer en un mot ? Une fois encore, la Gen Z a “adopté le terme adéquat [pour exprimer ce qu’elle ressent] dans notre époque instable et stressante”, écrit The Guardian.
Terme d’argot usité depuis dix ans par les Africains-Américains, il pourrait être résumé par : “Surtout, ne me cherche pas”, note le quotidien britannique. Il englobe tous les moments de perte de contrôle, de “craquage”, voire d’“accès de colère dû à un trop-plein de frustration”.
À ce jour, la définition la plus fiable semble être celle de l’Urban Dictionary, qui parle de “partir en vrille et/ou de faire n’importe quoi”, précise USA Today.
Avec un hashtag qui réunit plus de 600 000 publications, dont certaines ont dépassé le million de vues, le “crash out” permet de décrire un état émotionnel à part entière. Le mot figure même dans la dernière édition de la revue American Speech, et était parmi les finalistes pour le mot de l’année 2024, concours finalement emporté par l’expression “raw-dogging”.
Le craquage politique
Certains internautes utilisent cette expression pour qualifier “des réactions délibérément disproportionnées”, par exemple le fait de crier sur quelqu’un ou de crier seul, raconte également The New York Times. Le quotidien new-yorkais ajoute :
“[C’est] un sentiment allant au-delà de la fatigue, une exaspération ou une lassitude envers quelque chose ou quelqu’un, au point d’abandonner toute retenue et d’exploser.”
“Pour la génération TikTok, craquer, c’est perdre le contrôle de ses émotions et se laisser dominer par la colère ou s’effondrer psychologiquement”, abonde The Guardian. Ces jeunes ultra-connectés et aux prises avec des problèmes de santé mentale “trouvent qu’ils sont de plus en plus sujets à des explosions incontrôlables”.
Le terme avait déjà gagné en popularité durant la période électorale américaine de 2024, comme le soulignait le site Fast Company quelques jours après l’élection du 5 novembre dernier. Les internautes multipliaient alors les posts sur leurs moments de “craquage” à l’approche du jour J, l’appréhension quant à leur futur les rendant particulièrement fébriles.
Et c’était encore pire après l’élection, assurait USA Today en novembre, car “les gens qui n’étaient pas contents du résultat ressentaient le besoin de ‘craquer complètement’”.
Dans ces vidéos liées à l’actualité politique, ils “rejouaient en play-back des scènes de colère dans des films ou des séries ou pleuraient devant la caméra”, précisait le quotidien. Des mois plus tard, alors que le second mandat de Trump est vecteur d’instabilité et d’anxiété, le “crash out” n’est pas près de passer de mode.








