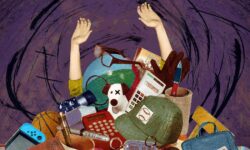[Cet article a été publié la première fois sur notre site le 1er juin 2025, et republié le 27 juin 2025]
Difficile de trouver le mot juste pour décrire le rapport que nous, Néerlandais, entretenons avec la culture américaine. Engouement ? Fascination ? Adoration ? À dire vrai, à ce sport national, les plus de 60 ans sont les meilleurs, surtout les hommes. Regardez-moi ces petits yeux se mouiller sitôt que Bruce Springsteen nous ressert son larmoyant The River ou que la voix grinçante de Bob Dylan jaillit de quelques haut-parleurs.
Regardez-les frémir dès que, en scrollant sur Netflix, ils tombent sur Apocalypse Now [de Francis Ford Coppola] ou Voyage au bout de l’enfer [de Michael Cimino]. Et que trouve-t-on s’il vous plaît dans les bibliothèques du royaume ? Je vous le donne en mille ! On the Road, de Jack Kerouac. Moby Dick, de Herman Melville. Plus tous les livres de Cormac McCarthy et Philip Roth.
Ou bien les meilleurs à ce sport seraient-ils les vingtenaires et les trentenaires (et avec eux les quadras et les quinquas, qui font pathétiquement tout pour rester dans le coup) ? Que n’importent-ils pas des États-Unis !
À commencer, of course, par la langue, qu’ils la néerlandisent ou non. Correctement ou non. Depuis “ghosten” à “cancellen” et “haten op” [verbes formés à partir de “to ghost”, ne plus donner signe de vie, “to cancel”, boycotter, ostraciser, et “to hate on”, détester quelqu’un que l’on jalouse], en passant par “cringe”, “awkward”, “anxiety” ou “consent” [“gênant”, “embarrassant”, “inquiétude” et “consentement”]. Ils parlent même de l’“administration” Trump, au lieu du “gouvernement”.
Mais ils n’importent pas que la langue. Tout le reste de la culture vient avec. Halloween. Le Black Friday. Les “gender reveal parties” – ces “fêtes de dévoilement du sexe” des enfants à naître. Les cupcakes. Le wokisme. Le mouvement #MeToo. Cette passion démesurée pour les Oscars. Et cette passion plus démesurée encore pour les séries. Quand les Néerlandais âgés de 20 à 60 ans tentent de donner un sens au monde, ils n’ont foi que dans The White Lotus. Et, comme ils croient dur comme fer que ces séries déterminent le “débat”, c’est effectivement ce qui se passe – dans leur petite bulle, en tout cas. Oui, les vingtenaires et compagnie sont bien les meilleurs à ce sport national.
Tourner le regard vers l’Europe
“Étaient”, devrais-je plutôt écrire. Car le charme s’est brisé avec le retour de Donald Trump, qui, le 30 avril, a fêté les cent premiers jours de sa seconde présidence. Or Donald Trump n’a pas la cote, c’est le moins que l’on puisse dire, auprès des hordes de Néerlandais qui adorent tout ce qui nous arrive d’Amérique. Et ils ne voient plus la culture de l’Oncle Sam du même œil.
Dans un article de NRC intitulé “L’Amérique, c’est fini”, la philosophe néerlandaise Stine Jensen écrit que “nous devrions songer à nous distancer de la culture américaine”. Par exemple en tournant notre regard vers l’Europe.
Bart Wallet, professeur en études juives, a partagé sur les réseaux sociaux la vidéo dans laquelle Volodymyr Zelensky se fait étriller par Donald Trump et son lieutenant J. D. Vance, vidéo qu’il commente ainsi : “Voilà ce que les Grecs anciens appelaient la confrontation entre la civilisation et les barbares.” Et de conclure : “Le moment est venu pour l’Europe de prendre clairement ses distances avec le gouvernement Trump.”
Mais pourquoi donc adorions-nous tout ce qui vient des États-Unis ? À bien y regarder, les Américains ne sont pas si adorables que cela. Avec leurs nippes informes, leur nourriture ultragrasse, leur frénésie des armes, leur fanatisme religieux, leur besoin pathologique d’avoir une machine pour faire chaque chose, leur addiction aux pilules et aux poudres en tout genre, leur puritanisme hypocrite. Faut-il que ce pays soit notre modèle ? Really ?
On pense ce que l’on veut de Donald Trump, mais si sa folle présidence nous permet de nous guérir de notre entichement pour l’Amérique, soyons-lui reconnaissant au moins sur ce point.
Quoi qu’il en soit, pour qu’une rupture se passe bien, il faut comprendre les raisons pour lesquelles on est tombé en amour. Le temps est donc venu de nous poser cette question : comment les Américains sont-ils devenus nos idoles ?
La démocratie américaine, d’inspiration française
L’été prochain marquera le dixième anniversaire de la première new-yorkaise de la comédie musicale Hamilton, de Lin-Manuel Miranda, dans laquelle des acteurs et chanteurs hauts en couleur mêlent rap, hip-hop et R’n’B pour raconter la genèse de l’Amérique. À l’époque, grands fans du spectacle, Barack et Michelle Obama reçoivent la troupe à la Maison-Blanche. Selon le Volkskrant, Hamilton est “la plus passionnante leçon d’histoire de tous les temps”. Donald Trump, pour sa part, a écrit sur Twitter que la comédie musicale est “largement surévaluée”.
Avec le recul, on pourrait dire que Hamilton, cette ode multiculturelle à toutes les valeurs qui, à la fin du XVIIIe siècle, ont fait des États-Unis d’Amérique un modèle, était une sorte de chant du cygne. Son producteur vient d’annuler les spectacles prévus en 2026 au Kennedy Center, repris en main par Trump, pour célébrer le 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance.
Hamilton parle des pères fondateurs des États-Unis (dont George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson et, naturellement, Alexander Hamilton) et de leurs discussions sur la liberté et l’égalité, sur la Constitution idéale et l’essence de la démocratie. Rappelons que les pères fondateurs se sont inspirés des penseurs des Lumières européens, dont le Français Charles de Montesquieu.
C’est de lui qu’ils tiennent l’idée fondamentale de séparation des pouvoirs. Montesquieu présente ce concept dans De l’esprit des lois (1748), livre où il explique qu’il faut séparer la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction judiciaire. Cette tripartition devait, pensait-il, empêcher des personnalités mégalomanes d’accaparer un pouvoir excessif. Les fondements de la Constitution américaine, qui commence par “Nous, le peuple”, sont donc français.
Plus tard, au début du XIXe siècle, celui qui pointe du doigt la fragilité de la démocratie américaine et met en garde contre une possible “tyrannie de la majorité” est lui aussi français : Alexis de Tocqueville. En 1884, la France offre aux États-Unis la statue de la Liberté, qui, à New York, accueille tous les nouveaux venus. Conçue par Frédéric Bartholdi (encore un Français), elle est assemblée autour d’un ingénieux squelette en fonte de Gustave Eiffel (itou).
Les États-Unis et la France, dont les histoires s’enchevêtrent depuis le début, ont tour à tour servi de modèle à l’Occident libre, même si, pour être honnête, précisons que dans le cas de la France, il s’agit surtout de Paris.
Paris, ancienne capitale du monde
C’est parce que nous sommes capables de rêver, de désirer, d’aspirer à quelque chose de meilleur que nous nous créons des modèles. Ils représentent à nos yeux un idéal dont nous voulons faire partie ou que nous voulons atteindre : pouvoir, beauté, intelligence, talent, richesse. Ces modèles stimulent notre imagination, qui s’en empare et les exalte. Sans imagination, pas de modèle.
En 1867, le livre Paris-Guide. Par les principaux écrivains et artistes de la France est publié à l’occasion de la deuxième Exposition universelle parisienne, avec une introduction rédigée par nul autre que Victor Hugo. Une introduction qui commence ainsi : “Au XXe siècle, il y aura une nation extraordinaire. […] Elle sera plus que nation, elle sera civilisation ; elle sera mieux que civilisation, elle sera famille.” Une famille dont tous les membres se comprendront, sans douanes ni préjugés, où nul n’aura à faire la guerre et tous sont libres.
“Cette nation aura pour capitale Paris, et ne s’appellera point la France ; elle s’appellera l’Europe. Elle s’appellera l’Europe au XXe siècle, et, aux siècles suivants, plus transfigurée encore, elle s’appellera l’Humanité.”
Il n’est pas si surprenant que Victor Hugo, en 1867, soit convaincu que Paris est appelé à devenir le centre glorieux de l’humanité. Le français est alors la langue de l’élite européenne et Paris est considéré comme la capitale du monde, un monde qui, croit-on, est promis à un brillant avenir : la science doit éradiquer la pauvreté et les maladies, l’art va rendre le monde beau.
À cette époque, l’Europe ne lorgne-t-elle pas du tout du côté des États-Unis ? Bien sûr que si. Dans la dernière décennie du XIXe siècle, les États-Unis connaissent leur âge d’or, une période de croissance économique rapide qui attire des immigrés de toute l’Europe. Les nouveaux riches américains emplissent leurs demeures clinquantes d’œuvres d’art du Vieux Continent.
Et inversement, la culture (de masse) américaine s’exporte vers l’Europe. Citons les spectacles de cirque de l’homme d’affaires Phineas Taylor Barnum (dont le célébrissime Greatest Show on Earth) et les spectacles itinérants Wild West Shows de Buffalo Bill – les Américains ont très vite compris que les divertissements idiots pouvaient rapporter gros.
Les États-Unis, sauveurs de l’Europe
Reste que dans le domaine culturel, même après la Seconde Guerre mondiale, Paris reste “the place to be”. Dans les années 1920, ces années dites “folles”, de nombreux écrivains américains comme Ernest Hemingway, T. S. Eliot et F. Scott Fitzgerald s’y installent pour travailler, tout comme les premiers musiciens (de jazz) américains de couleur, qui, à Paris, subissent nettement moins de discriminations et de racisme qu’aux États-Unis.
Paris est la ville qui a le plus à offrir à un écrivain, écrit Hemingway dans Paris est une fête. La vie y est relativement bon marché et, l’hiver, les jeunes artistes démunis peuvent se réchauffer autour de la grande cheminée de Gertrude Stein, au 27, rue de Fleurus, qui leur sert un verre de prune en les surnommant “génération perdue”.
Après la Seconde Guerre mondiale, les choses changent. En 1945, l’Europe est à terre, les villes détruites et, sans les libérateurs américains, l’avenir du continent serait fort sombre. C’est en France que les Américains débarquent. Depuis, lors des commémorations du Débarquement, le président français en service se tient debout, l’air déconfit, comme s’il trouverait plus juste que les rôles soient inversés.
Malgré tout, dans les premières années de l’après-guerre, il ne reste qu’“un seul endroit dans toute l’Europe où l’on peut véritablement parler de vie intellectuelle européenne”, écrit l’historien britannique Tony Judt en 2006 dans son livre Après-guerre. Une histoire de l’Europe depuis 1945. Les intellectuels français jouissent, selon Judt, du “statut particulier, international, de porte-parole de leur époque : Paris est à nouveau – et pour la dernière fois à ce jour – la capitale de l’Europe”.
Au cours de la décennie suivante, la France reste méfiante vis-à-vis de l’Amérique. Aux films lissés made in Hollywood, la France oppose son renommé cinéma d’auteur. Quand les États-Unis ne jurent que par le libre marché, la France bichonne son secteur public. Travailler jusqu’à la mort ? Que nenni ! Vive la retraite, et le plus tôt possible, s’il vous plaît ! Du savoir-vivre, que diable ! Même les populistes français n’ont guère de sympathie pour Trump.
La domination de l’anglais
Tandis que la cheffe américaine Julia Child fait découvrir aux Américains la cuisine française dans ses émissions de télévision à succès, à partir des années 1950, la France perd peu à peu son statut de modèle aux yeux des Pays-Bas.
Pendant quelque temps encore, certes, des artistes néerlandais partent s’installer dans la Ville Lumière (pensons à l’écrivain Remco Campert [1929-2022], au peintre Corneille [1922-2010] ou au romancier Jan Cremer [1940-2024]). Citons également le journaliste Jan Brusse, qui fait de son mieux pour entretenir la flamme des Néerlandais pour la ville (“Je pourrais vous parler pendant des heures des Champs-Élysées. Les plus élégantes Parisiennes viennent y exhiber leurs dernières toilettes. Voyez un peu comme elles marchent !”). Mais le charme n’opère plus.
Désormais, c’est l’Amérique qui fait rêver. L’Amérique, pays des libérateurs, du plan Marshall, de Barbie, de Kennedy, de Woodstock et du jean, de Facebook et d’Obama. Les États-Unis restent longtemps un symbole de progrès, de quelque chose de supérieur, comme le fut Paris au temps de l’Exposition universelle de 1867.
Jusqu’à nos jours, donc. Bien sûr, la langue y est pour quelque chose. Si plus personne ne parle allemand ou français aux Pays-Bas, tout le monde maîtrise plus ou moins l’anglais. Chaque année, les Néerlandais achètent de fait un peu plus de livres et écoutent un peu plus de podcasts en anglais.
Mais ce succès garde tout de même quelque chose de mystérieux. Les Américains ne sont pas devenus des barbares du jour au lendemain. L’appauvrissement de la culture européenne, notamment en conséquence de l’américanisation, ne date pas non plus d’hier. En 2006, l’écrivain italien Alessandro Baricco y consacrait d’ailleurs un essai remarquable : Les Barbares.
Bref, si nous tenons tant à avoir un modèle, pourquoi ne pas donner de nouveau sa chance à la France ? C’est un pays magnifique, accessible en train, où on mange divinement bien. Les Françaises ne carburent pas au botox : elles se choisissent un bon coiffeur.
La France a l’arme atomique mais aussi le croissant au beurre. On y a encore le droit de jurer, de fumer et de boire – avec une espérance de vie bien plus élevée qu’aux États-Unis. Voici donc quelques mots en guise de mise en bouche : merde, putain, con. C’est ouf ! C’est nul ! À toute !*
Qu’attendez-vous encore ? Allez-y, foncez !
* En français dans le texte.