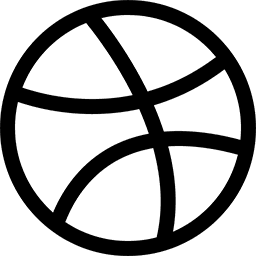Par Mohamed Salah Ben Ammar
Ces derniers temps, la Tunisie connaît une vague d’arrestations touchant des hommes d’affaires, des politiciens et des figures publiques dans le cadre de la lutte contre la corruption ou d’atteinte à la sécurité de l’État.
Les autorités justifient ces actions par la nécessité de rétablir l’ordre et de combattre les réseaux d’influence illégaux. Les discussions dans les cafés et sur les réseaux sociaux vont bon train.
Elles sont alimentées, faute d’informations officielles, par les convictions toujours non fondées de chacun. Soulignons tout de même que, dans ce climat, la présomption d’innocence n’a plus aucun sens, et ces personnes se retrouvent souvent condamnées par les médias et l’opinion publique avant même d’avoir été jugées.
Une enquête nationale révèle que 61,2% de nos concitoyens estiment que la corruption est omniprésente dans tous les secteurs.
Une corruption du quotidien, ignorée et tolérée
Pourtant, étrangement, une forme de corruption plus insidieuse et beaucoup moins médiatisée sévit. Elle bénéficie d’une forme de tolérance, voire d’indulgence.
Elle est omniprésente au quotidien, chaque fois que nous avons affaire à un pouvoir quelconque, si insignifiant soit-il.
Certes, il s’agit de faits moins spectaculaires que ceux des élites ; néanmoins, ils n’en sont pas moins significatifs en raison de leur fréquence.
On peut, sans grand risque de se tromper, supposer qu’ils entravent le fonctionnement de l’administration ou qu’ils sont à l’origine du non-respect des règles dans certaines circonstances, provoquant des passe-droits qui pénalisent des personnes ou des institutions. Laisser conduire une personne en état d’ébriété, c’est exposer les autres à un danger, par exemple.
« Affrah Biya » : une corruption banalisée
Récemment, une amie a été confrontée à une situation qui pourrait être qualifiée de racket au sein d’une administration publique. Deux fonctionnaires d’une trentaine d’années l’ont menacée de poursuites judiciaires en raison d’un retard dans la déclaration d’un contrat. Sous cette pression, ils lui ont dit « Affrah Bina ». Ne comprenant pas immédiatement, elle a fini par comprendre que ces deux fonctionnaires exigeaient explicitement de l’argent liquide. N’ayant que soixante dinars sur elle, ils ont accepté cette somme dérisoire.
Cette expérience l’a profondément marquée, non pas tant pour la somme ou la menace, mais pour l’atteinte à la dignité d’une institution qu’elle respectait.
Combien d’honnêtes citoyens ont été contraints d’assumer l’atteinte suprême à leur honneur et de corrompre un fonctionnaire ?
Malheureusement, ce type de situation n’est pas isolé. De nombreux témoignages font état d’une augmentation de ces pratiques dans tous les domaines, souvent accompagnées d’un sentiment d’impunité dans certaines administrations. De façon étrange, ces pratiques semblent être devenues la norme dans certains secteurs.
Une lutte contre la corruption aux motivations politiques
En réalité, la lutte contre la corruption en Tunisie n’a jamais été abordée de façon méthodique et professionnelle. Ce fléau a systématiquement été traité au gré des enjeux politiques plutôt que par un réel désir de changement.
Déjà, du temps des Beys, elle permettait d’exproprier certains tombés en disgrâce du palais de Bardo.
Après l’indépendance en 1956, cette lutte a été régulièrement utilisée comme un moyen de consolider le pouvoir des dirigeants en place, tout en écartant les opposants.
Sous le régime de Habib Bourguiba, la lutte anticorruption a été instrumentalisée pour renforcer son autorité. En ciblant ses opposants avec des accusations de corruption, il a pu régler des comptes.
Lorsque Zine El Abidine Ben Ali a accédé au pouvoir, il a lancé des campagnes anticorruption pour légitimer son régime. Cependant, ses efforts ont rapidement montré leurs limites, car son clan familial a établi un système de corruption institutionnelle généralisée.
Après la Révolution de 2011, l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) a été créée, suscitant l’espoir d’un changement réel. Ses activités sont gelées depuis 2021.
Une justice à deux vitesses
Les gouvernements successifs ont souvent été accusés d’instrumentaliser la lutte contre la corruption à des fins politiques, notamment à travers l’article 96 du Code pénal. L’opération « Mains Propres » de Youssef Chahed, par exemple, a été qualifiée de grotesque.
Sous le régime actuel, les arrestations de figures politiques ont également été dénoncées comme des actions visant principalement les opposants, illustrant une justice à deux vitesses.
Les conséquences alarmantes d’une corruption endémique
La corruption freine l’investissement et érode la confiance des citoyens.
L’Indice de Perception de la Corruption (IPC) de 2023 indique que la Tunisie, avec un score de quarante sur cent, reste éloignée des normes internationales.
Ces éléments montrent que, malgré certaines initiatives positives, la lutte contre la corruption reste entachée de motivations politiques. La corruption ne naît pas de rien ; elle a des racines profondes et des causes structurelles qui doivent être traitées.
Un combat qui doit être méthodique et impartial
La lutte contre la corruption en Tunisie est essentielle, mais elle ne doit pas être abordée sous un prisme purement moral.
Trop souvent instrumentalisée à des fins de pouvoir, cette lutte perd en efficacité et alimente la méfiance des citoyens envers la sincérité des autorités.
Pour être fructueuse, elle doit être menée avec méthode, transparence et impartialité, impliquant tous les acteurs de la société.
Une véritable expertise est nécessaire et cette lutte demande du temps, et non des effets d’annonce.
Comme dans toute chose, la lutte contre la corruption répond à une méthodologie codifiée et exige des compétences précises.
Un engagement collectif est crucial pour instaurer un environnement où la corruption devient inacceptable et où la confiance des citoyens envers leurs institutions peut être restaurée.
* Pr Mohamed Salah Ben Ammar MD – MBA