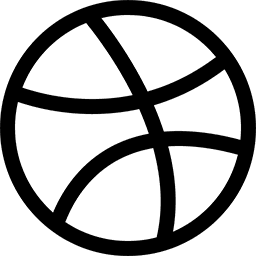Le 24 janvier, les Croates ont massivement boycotté les commerces, provoquant une chute du chiffre d’affaires de 50 % [selon l’administration fiscale]. Peu importe son impact sur la baisse de prix de consommation, ce boycott des chaînes de grande distribution est un événement inédit en Croatie. On n’y recourt pas souvent dans d’autres pays non plus.
Il y a deux ans, les Canadiens ont boycotté la plus grande chaîne de grande distribution, Loblaws, en raison de l’inflation. L’année dernière, les Italiens ont participé à une “grève de la nourriture” en raison du prix élevé des pâtes. Ni le premier ni le deuxième boycott n’ont eu d’effet : les prix n’ont pas baissé, mais au moins les gens ont montré les dents.
Pourquoi les Croates recourent-ils au boycott maintenant ? Comment se fait-il que ce peuple considéré jusqu’alors comme apathique, en ait finalement eu assez ? Et ceci alors que les salaires ont augmenté de 35 % en deux ans, que l’inflation a baissé, et que la consommation a grimpé en flèche ?
La petite goutte qui a fait déborder le vase a été le prix des denrées alimentaires, élément le plus important dans le budget de chaque famille. La nourriture est devenue excessivement chère. Selon le Bureau croate de statistiques, depuis 2023 et l’entrée de la Croatie dans la zone euro, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 34 % [Dans l’UE, en décembre 2024, les taux d’inflation annuels les plus élevés étaient ceux de la Roumanie (5,5 %), de la Hongrie (4,8 %) et de la Croatie (4,5 %), selon Eurostat].
Le ministre de l’Économie soutient le boycott
Une récente analyse de Jutarnji List, a démontré que sur les 30 principaux produits vendus dans les chaînes de grande distribution, la moitié est 30 à 60 % plus cher qu’il y a deux ans : notamment les œufs, le pain, le thé, le café, la viande et le poisson. Quelle est la raison de cette hausse excessive des prix ?
Le gouverneur de la Banque nationale, Boris Vujcic, n’en a aucune idée. Le ministre de l’Économie [Ante Susnjar